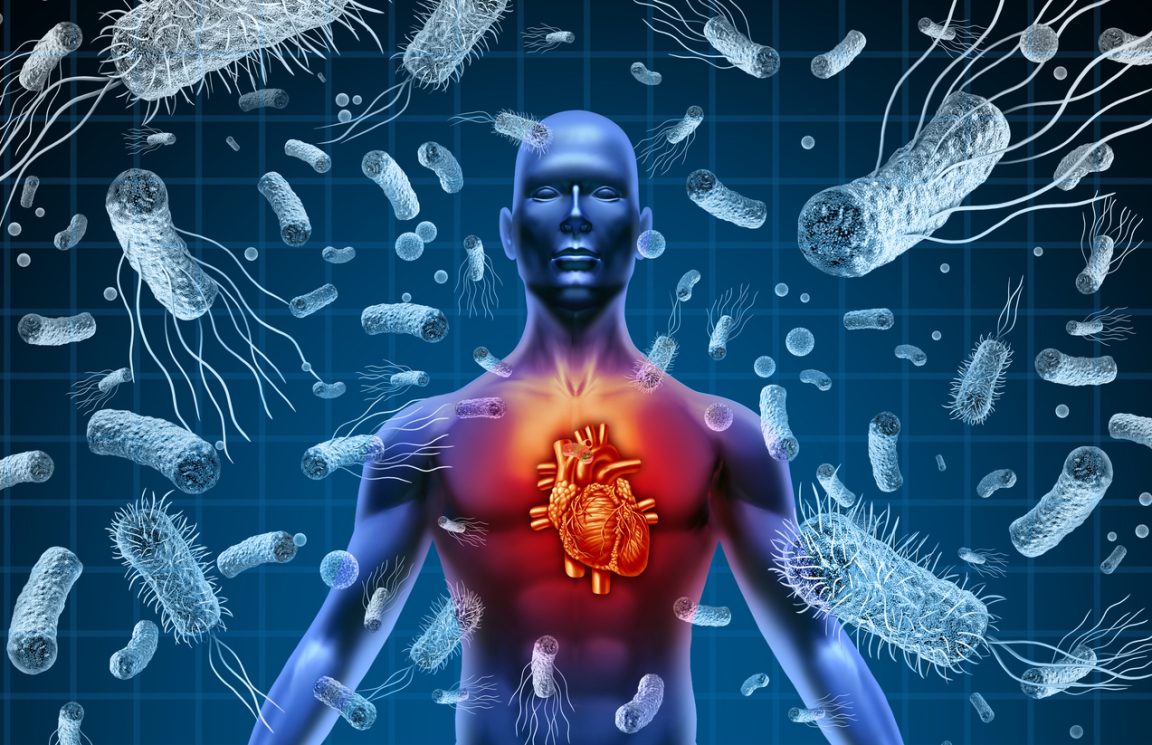Ce sont le plus souvent les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes déjà malades ou les enfants qui sont le plus exposés à la septicémie. D’ailleurs, près de la moitié des cas sont des enfants de moins de cinq ans et on considère que quinze patients sur mille subiront cette complication au cours de leur hospitalisation. Toutefois, personne n’est à l’abri de ce mal méconnu et particulièrement grave. Mis bout à bout, des chiffres atteignent ainsi un nombre vertigineux de 48,9 millions de cas et de 11 millions de décès rien qu’en 2017, soit 20 % des décès à l’échelle mondiale. Pour endiguer ce mal qui tue plus que le cancer dans le monde, la recherche se poursuit inlassablement.
Et justement, une étude récente vient d’apporter sa pierre à l’édifice en mentionnant une piste thérapeutique très simple à mettre en place qui pourrait sauver de très nombreuses vies.
Septicémie : de quoi s’agit-il au juste ?
La septicémie, également connue sous le nom de sepsis, est une réponse inflammatoire grave et potentiellement mortelle du corps à une infection. Elle survient lorsque des agents pathogènes (bactéries, virus, champignons ou parasites) pénètrent dans le sang et déclenchent une réaction excessive du système immunitaire. Cette réaction peut causer une inflammation généralisée et des dommages aux tissus et aux organes.
Cela démarre le plus souvent par une infection localisée (comme une pneumonie, une infection urinaire, une péritonite, une infection abdominale et même une plaie infectée ou une dent mal soignée), mais des cas de méningites à méningocoques ou de syndromes de choc toxique à staphylocoques lié à l’utilisation de tampons ou coupes menstruelles ne sont pas rares non plus. Faute de soin, les agents pathogènes peuvent pénétrer dans la circulation sanguine, entraînant alors la septicémie. Le système immunitaire réagit alors à l’infection par une libération massive de cytokines, ce qui provoque une inflammation généralisée. L’inflammation et la coagulation sanguine anormale peuvent ensuite perturber le flux sanguin.
Quelles conséquences pour le patient ?
Les risques encourus et les complications sont multiples, et peuvent être très graves surtout en cas de choc septique, la forme la plus grave de la septicémie. Cela peut en effet entraîner la défaillance de plusieurs organes simultanément (poumons, reins, cœur, etc.). Cette défaillance multiviscérale nécessite alors des soins intensifs. Comme évoqué tantôt, il y a également un taux de mortalité élevé et même avec un traitement, le risque de décès reste significatif.
Et si des patients survivent, ils peuvent souffrir de séquelles à long terme, telles que des troubles cognitifs, une fatigue persistante et des douleurs chroniques. La coagulation sanguine excessive réduit par ailleurs la circulation vers les extrémités et entraîne une nécrose tissulaire. Cette nécrose peut donc nécessiter une amputation pour prévenir la propagation de l’infection et sauver la vie du patient, ce qui laisse aussi des traces.
La recherche se poursuit donc pour une meilleure prise en charge de cette affection grave. Et si une prise en charge rapide est essentielle, cette nouvelle étude propose une piste thérapeutique qui pourrait aussi faire toute la différence.

Une piste pour mieux soigner le sepsis
D’après cette étude menée conjointement par l’Université du Queensland et le George Institute for Global Healt (tous deux en Australie) et publiée le 12 juin 2024 dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), le bon protocole de soin impliquerait finalement un changement très simple. Des essais cliniques accompagnés d’une revue systématique démontrent en effet que l’administration en continu d’un antibiotique plutôt qu’en plusieurs injections courtes pouvait sauver des milliers de vies chaque année.
Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont cherché à déterminer la concentration optimale de médication pour venir à bout des agents pathogènes à l’origine de l’infection grâce à des essais cliniques dans plus d’une centaine d’hôpitaux situés dans plusieurs pays auprès de milliers de patients et la méta-analyse de précédentes études.
Or, comme l’explique le professeur Jason Roberts, directeur d’un Institut de recherche australien et du Herston Infectious Diseases Institute : « nous avons découvert qu’administrer ces doses d’antibiotiques en perfusion continue, nous pouvons maintenir les concentrations de médicament dans le sang et les tissus du patient, avec de meilleures chances de tuer les bactéries. Cette simple intervention utilise des antibiotiques très communs. Ainsi, même de petits hôpitaux dans des pays du tiers monde pourront mettre en place ce changement de dosage au moins aussi facilement que dans des hôpitaux qui ont accès à plus de ressources dans des pays développés. »
Bientôt dans les hôpitaux ?
Les chercheurs estiment avoir obtenu des résultats significatifs grâce à l’administration continue, avec une vie sauvée par tranche de 26 patients traités. Ils espèrent à présent que ces recherches permettront d’améliorer le soin de la septicémie et pourront ainsi augmenter les chances de survie des patients.
Comme le rappelle en effet le professeur Jeffrey Lipman, qui étudie depuis plus de vingt ans ce sujet, « les médecins suivent les directives internationales pour traiter les patients, mais pour l’instant, ces recommandations proposent très peu de certitudes sur la manière d’administrer les médicaments. Grâce à notre programme de recherche, les protocoles de traitement et les lignes directrices seront à présent plus sûrs. En considérant la nature très simple de ces découvertes et les échanges que nous avons entre les hôpitaux, nous nous attendons à ce que la plupart adoptent ces changements immédiatement. »
Pour plus de détails, les chiffres proviennent du site de l’OMS et les conclusions de ces travaux sont à consulter ici et sur ce lien.