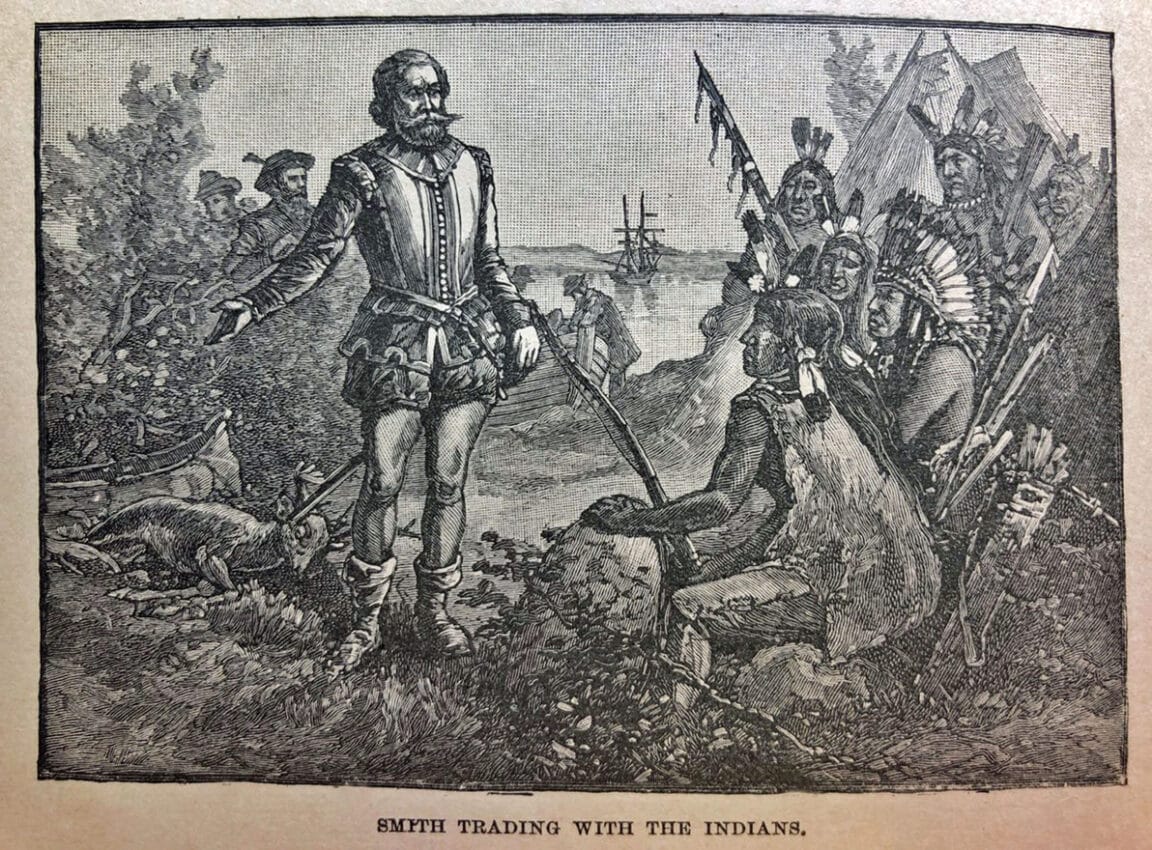Les morts de plusieurs dizaines de millions d’Amérindiens successives à l’arrivée des colons européens auront conduit à l’abandon de 56 millions d’hectares de terres cultivées. Et visiblement, cela n’a pas été sans conséquence pour la planète.
La Grande mort
L’arrivée des Européens en Amérique à partir de 1492 a eu de multiples conséquences dramatiques pour les populations amérindiennes présentes sur place depuis des millénaires. Très vite, des conflits violents ont éclaté entre les populations autochtones et les colons européens qui cherchaient à s’approprier les terres, les ressources naturelles et autres richesses des Amériques.
Les politiques coloniales et les pratiques d’exploitation économique ont également eu un impact dévastateur. Les Amérindiens ont en effet été soumis à l’esclavage, à l’exploitation minière, à l’expropriation de leurs terres et à l’exploitation des ressources naturelles sans égard pour leur bien-être.
Enfin et surtout, les maladies infectieuses apportées par les Européens, telles que la variole, la grippe et la rougeole, se sont répandues très rapidement parmi les populations amérindiennes qui n’avaient pas développé d’immunité contre ces nouvelles infections. Ces épidémies ont alors décimé de vastes segments de la population, affaiblissant considérablement les sociétés indigènes. Il y a quelques années, une équipe de l’University College de Londres avait estimé la population amérindienne à plus de 60 millions en 1492, sur la base de documents historiques comprenant la taille des armées, les données de recensement et les découvertes archéologiques. Au cours du siècle qui suivit, l’équipe suggère que des agents pathogènes nouvellement introduits ont tué environ 90% de la population. C’est pourquoi on parle de « Grande mort ».
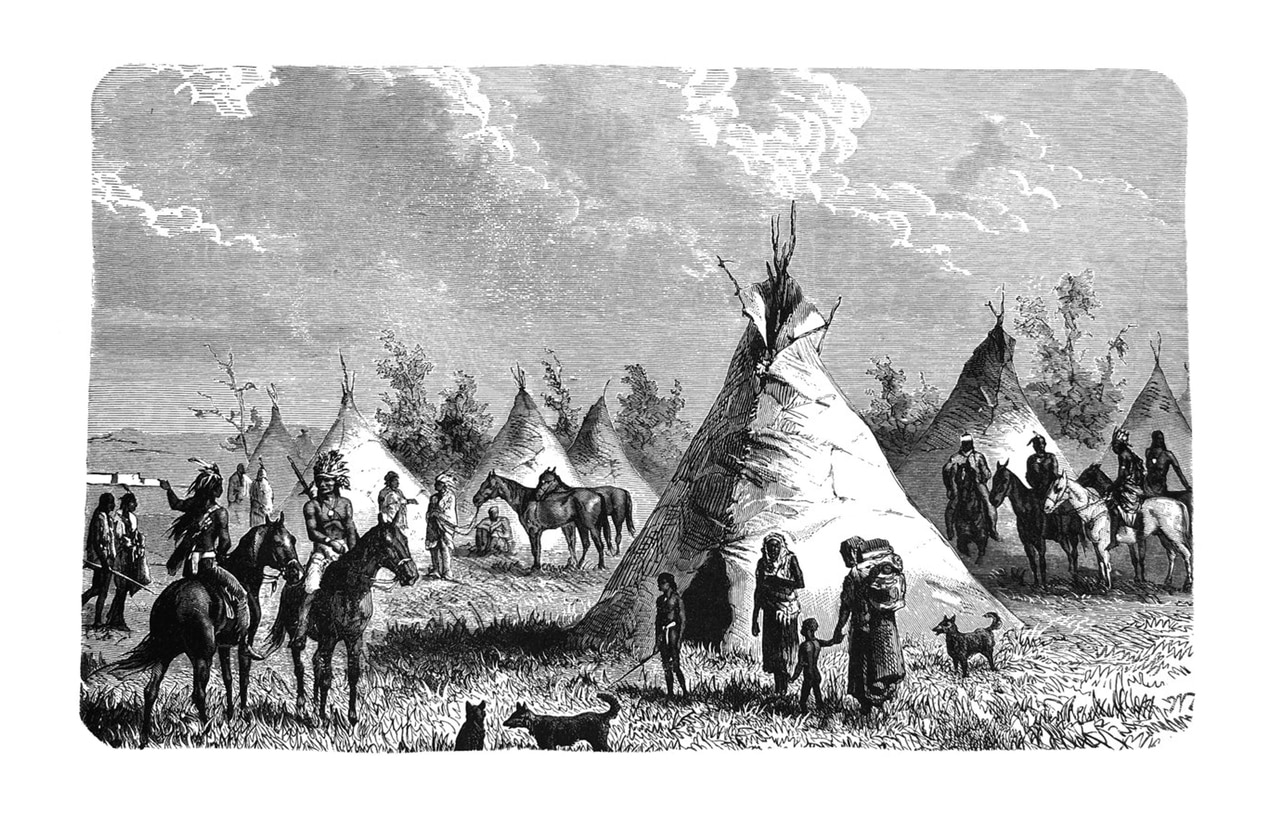
Transformation des terres
Nous savons que l’utilisation indigène des terres était répandue avant l’arrivée des Européens, en particulier au Mexique, en Amérique centrale, en Bolivie et dans les Andes. Par la suite, l’arrivée des Européens a entraîné une réduction drastique de leur utilisation (56 millions d’hectares). Les champs et les jachères auraient alors subi de multiples transformations avant de finalement revenir à leurs états antérieurs.
Autrement dit, les terres précédemment cultivées se sont transformées en forêts et en savanes. Or, ces dernières absorbent plus de carbone que les terres agricoles, ce qui n’a pas été sans conséquence. Dans un article publié en 2019 dans Quaternary Science Reviews, une équipe avait d’ailleurs déterminé que la transformation de ces terres avait entraîné, du moins en partie, le Petit Âge Glaciaire.

Une baisse importante des niveaux de CO2
Le Petit Âge Glaciaire fait référence à une période de refroidissement climatique qui s’est étendue approximativement du 14e au 19e siècle. Cette période fut marquée par des hivers particulièrement rigoureux, des étés plus frais et des variations climatiques importantes dans plusieurs régions du monde. On estime que les températures moyennes ont baissé d’environ 1 à 2°C par rapport à la période précédente.
Les causes exactes de ce Petit Âge Glaciaire ne sont pas encore entièrement comprises. Des facteurs naturels tels que l’activité solaire réduite, les éruptions volcaniques majeures et les variations dans les courants océaniques sont parfois considérés comme des influences possibles.
Dans leur étude, les chercheurs avaient cependant déterminé que l’absorption de carbone par les terres précédemment cultivées avait réduit les niveaux de CO2 atmosphérique au point de conduire à une baisse du forçage radiatif, ce qui pourrait alors avoir contribué au Petit Âge Glaciaire. On observe en effet une baisse du CO2 dans les carottes de glace à cette époque (environ 7 à 10 parties par million).
Si des processus tout à fait naturels ont effectivement participé à cet événement glaciaire, le génocide arménien a donc peut-être été l’un des facteurs les plus influents. Selon les chercheurs, la « Grande mort » des peuples autochtones des Amériques aurait en effet entraîné un impact mondial d’origine humaine sur le système terrestre au cours des deux siècles précédant la révolution industrielle.