Deux géographes britanniques de l’Université de York et de la London School of Economics avancent une hypothèse aussi troublante qu’innovante : le changement climatique a tellement bouleversé les rythmes terrestres que nos concepts traditionnels de printemps, été, automne et hiver sont devenus obsolètes. Leur étude, publiée dans Progress in Environmental Geography, propose de reconnaître quatre nouveaux types de « saisons » qui émergent sous nos yeux, transformant fondamentalement notre rapport au temps et aux cycles naturels.
Quand la nature perd ses repères
Depuis notre enfance, nous avons appris à reconnaître les signes immuables des saisons : les bourgeons du printemps, la chaleur estivale, les feuilles d’automne, le froid hivernal. Cette rythmique millénaire, dictée par l’inclinaison de 23,5 degrés de notre planète, continue certes de régir les variations de température et de luminosité. Mais l’expérience humaine de ces cycles connaît une mutation profonde.
Les chercheurs ne remettent pas en question les mécanismes astronomiques fondamentaux. La Terre conserve son inclinaison, et les pôles reçoivent toujours moins d’énergie solaire que l’équateur selon un cycle annuel prévisible. Ce qui change radicalement, c’est la manifestation concrète de ces variations dans notre quotidien.
Les données scientifiques confirment cette transformation : les étés s’allongent et s’intensifient, les hivers raccourcissent et s’adoucissent, les printemps arrivent avec plusieurs semaines d’avance. Ces bouleversements ne relèvent plus de l’anecdote météorologique mais constituent une réorganisation profonde des rythmes planétaires.
Quatre nouvelles saisons pour un monde nouveau
Face à cette réalité, les géographes proposent une grille de lecture révolutionnaire articulée autour de quatre catégories de « saisons modernes » :
Les saisons émergentes désignent des cycles entièrement nouveaux, inexistants par le passé. L’exemple le plus frappant concerne les « saisons de brume » qui affectent désormais l’Asie du Sud-Est. En Indonésie, Malaisie et Singapour, les populations ont appris à anticiper les périodes annuelles de pollution massive causées par les incendies de tourbières. Ce qui relevait autrefois de l’accident environnemental est devenu un risque saisonnier prévisible, donnant naissance à de nouvelles habitudes sociales.
Les saisons disparues correspondent aux cycles traditionnels devenus méconnaissables ou ayant totalement disparu. Certaines régions ne connaissent plus de véritables hivers, tandis que d’autres voient leurs saisons intermédiaires s’effacer progressivement.
Les saisons arythmiques traduisent la perturbation des calendriers naturels habituels. Les migrations animales se décalent, les floraisons surviennent à contretemps, créant un décalage croissant entre les cycles biologiques et les repères temporels humains.
Enfin, les saisons syncopées caractérisent l’irrégularité croissante de l’intensité saisonnière. Les variations deviennent imprévisibles, alternant brutalement entre extrêmes climatiques au sein d’une même période.
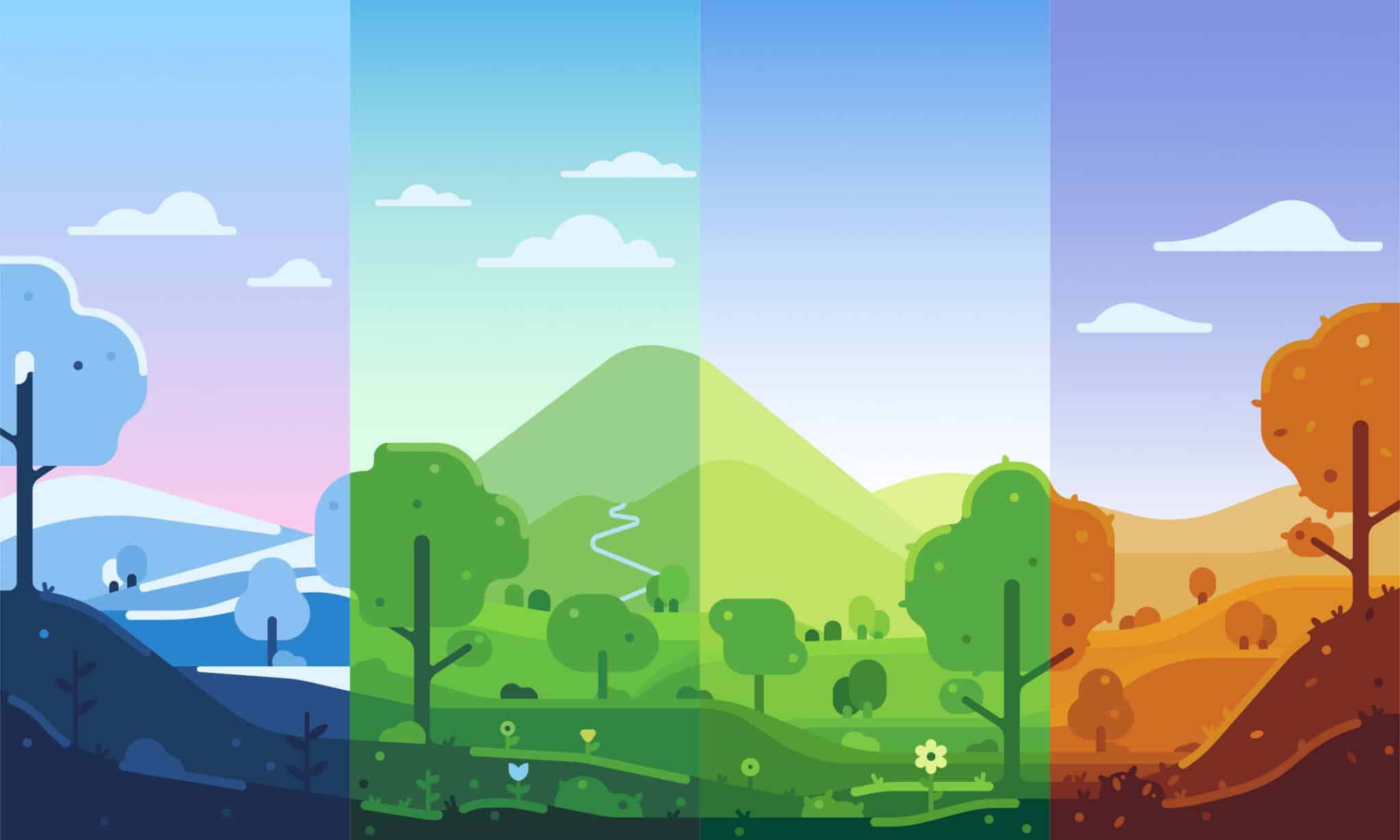
L’adaptation par la reconnaissance
Cette approche conceptuelle dépasse la simple théorisation académique. L’exemple des « saisons de brume » asiatiques illustre parfaitement son potentiel pratique. En reconnaissant le caractère saisonnier de cette pollution, les sociétés concernées ont développé des réponses efficaces : systèmes de prévision spécialisés, généralisation des purificateurs d’air domestiques, campagnes de santé publique ciblées.
Cette reconnaissance permet une adaptation proactive plutôt que réactive. Au lieu de subir passivement des perturbations perçues comme chaotiques, les communautés peuvent anticiper et se préparer à des cycles certes nouveaux, mais néanmoins prévisibles.
Repenser notre relation au temps
La proposition de ces géographes ne vise pas à abolir le printemps ou l’été, mais à enrichir notre vocabulaire saisonnier pour mieux appréhender la réalité contemporaine. Il s’agit d’une évolution culturelle et sociale plutôt que d’une révision calendaire.
Cette flexibilité conceptuelle pourrait s’avérer cruciale pour naviguer dans un monde où les règles climatiques traditionnelles perdent leur pertinence. Reconnaître l’émergence de nouvelles saisons constitue peut-être le premier pas vers une adaptation réussie aux défis environnementaux du XXIe siècle.
Finalement, cette étude nous invite à reconsidérer notre rapport au temps naturel, non pas comme une donnée figée, mais comme une réalité vivante qui évolue avec notre planète.


