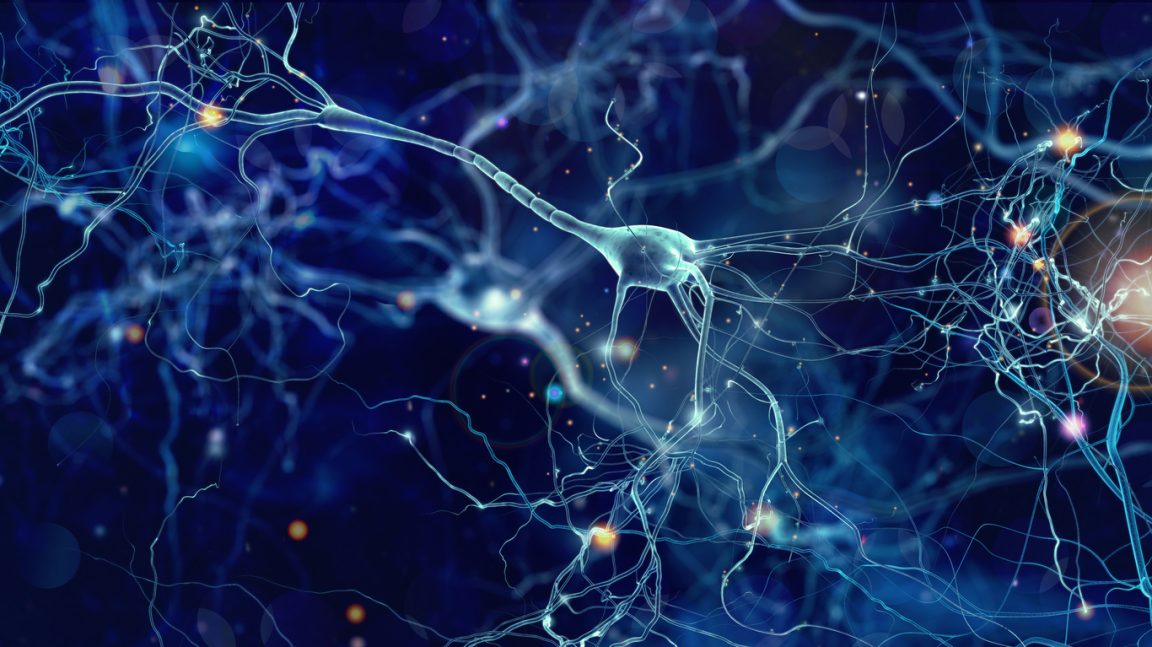Des scientifiques ont récemment identifié un réseau cérébral spécifique impliqué dans le bégaiement, révélant de nouvelles pistes pour comprendre et traiter ce trouble de la parole. Cette découverte pourrait révolutionner les approches thérapeutiques, notamment par l’utilisation de la stimulation électrique du cerveau.
Les types de bégaiement
Le bégaiement est un trouble de la parole qui touche environ 1 % des adultes et entre 5 % et 10 % des enfants. Il se manifeste par la répétition ou la prolongation involontaire de sons, syllabes et mots ainsi que par des « blocages » dans la parole qui rendent la communication difficile et peuvent provoquer de l’anxiété sociale.
On distingue principalement deux types de bégaiement :
- Le bégaiement développemental qui apparaît dans l’enfance et disparaît souvent avant l’âge de 18 ans dans 90 % des cas.
- Le bégaiement acquis, moins courant, qui survient après une lésion cérébrale comme un accident vasculaire cérébral (AVC) ou des maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson.
L’importance de poursuivre les recherches
Malgré les avancées actuelles, il est crucial de poursuivre les recherches dans ce domaine pour plusieurs raisons essentielles. Actuellement, l’orthophonie est le principal traitement du bégaiement, mais ses bénéfices ne sont pas toujours durables et il n’existe aucun médicament efficace pour traiter ce trouble. Comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents permettrait donc de développer de nouvelles thérapies potentiellement plus efficaces et durables.
En outre, le bégaiement peut considérablement affecter la qualité de vie, et entraîne souvent une anxiété sociale et des difficultés de communication. Des traitements plus efficaces pourraient aider à réduire ces impacts négatifs, ce qui améliorerait ainsi la qualité de vie des patients.
Enfin, poursuivre les études sur le bégaiement contribue également à l’enrichissement des connaissances sur le fonctionnement du cerveau humain. Chaque découverte offre en effet des informations précieuses qui peuvent avoir des implications pour d’autres domaines de la neuroscience.

Un réseau neuronal impliqué
Pour mieux comprendre l’origine du bégaiement, des chercheurs ont examiné des rapports de cas médicaux de vingt personnes qui ont commencé à bégayer après un AVC. Ils ont comparé ces dossiers à ceux de près de 170 patients victimes d’un AVC qui n’ont pas développé de bégaiement. Les résultats ont alors montré que les lésions cérébrales chez ceux qui bégaient étaient situées dans différentes parties du cerveau, mais toutes reliées par le même réseau cérébral qui relie trois régions principales du cerveau : l’amygdale, le putamen et le claustrum. Ce schéma n’a pas été observé chez ceux qui ne bégaient pas.
Pour rappel, l’amygdale est impliquée dans la régulation des émotions, le putamen dans le contrôle des mouvements et le claustrum dans le relais des informations entre différentes zones du cerveau. Cette compréhension pourrait permettre de développer des traitements plus ciblés pour le bégaiement.
En complément, les chercheurs ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour scanner le cerveau de vingt personnes ayant développé un bégaiement après un AVC, ainsi que celui de vingt adultes présentant un bégaiement développemental. Les résultats ont révélé une corrélation entre la gravité des symptômes et la structure de la matière grise dans le réseau cérébral identifié. Plus le volume de matière grise dans ce réseau était important, plus le bégaiement était sévère.
Quelles implications et perspectives ?
Ces découvertes, rapportées dans la revue Brain, suggèrent ainsi qu’un réseau cérébral commun est à l’origine du bégaiement, et ce, quel que soit son déclencheur initial. Cela ouvre la possibilité de cibler ce réseau pour traiter ce trouble de la parole. La stimulation électrique du cerveau, déjà utilisée pour traiter des troubles comme le trouble obsessionnel compulsif, la dépression, la maladie de Parkinson et les tremblements essentiels, pourrait également être envisagée.
Bien que ces découvertes soient prometteuses, les chercheurs notent qu’il faudra cependant encore des années de recherche avant de concrétiser ces visions thérapeutiques. La prochaine étape consistera à affiner les techniques de stimulation cérébrale et à les tester dans des essais cliniques plus larges. En attendant, ces avancées offrent un nouvel espoir pour les personnes souffrant de bégaiement et pourraient transformer les approches actuelles de traitement.