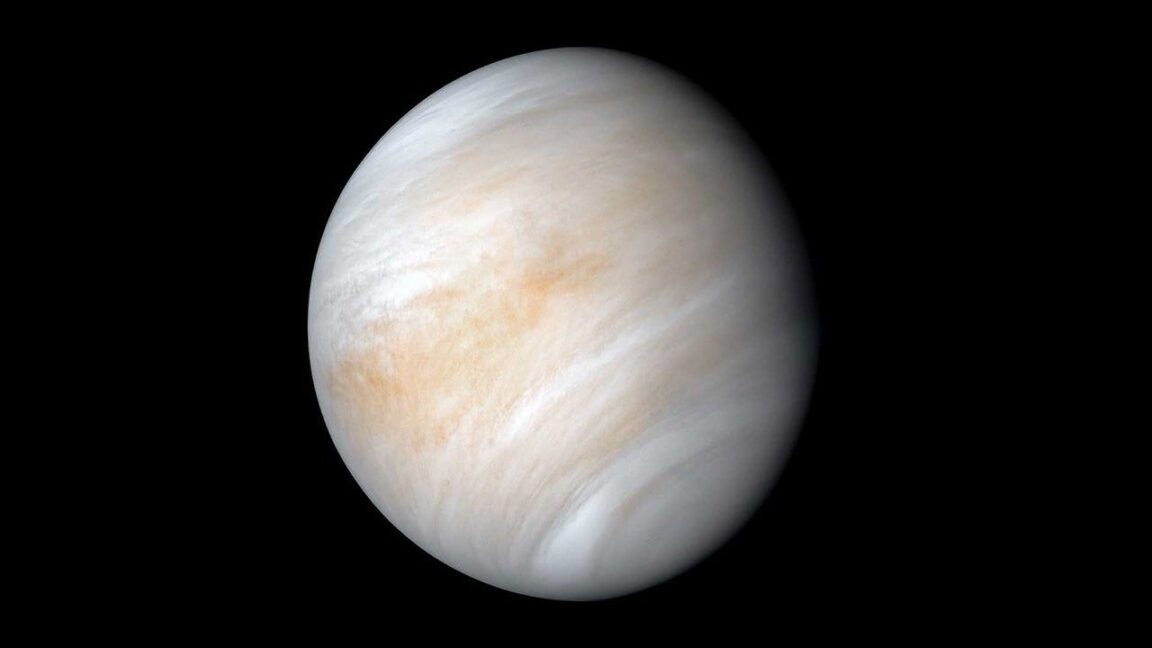Qui aurait cru que des satellites conçus pour scruter les typhons et les masses nuageuses au-dessus de l’Asie du Sud-Est serviraient un jour à surveiller l’atmosphère brûlante de Vénus ? C’est pourtant ce que vient de révéler une équipe japonaise : grâce à un alignement chanceux et à une bonne dose d’ingéniosité, des instruments météo en orbite terrestre ont permis d’observer l’évolution des températures des nuages de Vénus… pendant près de dix ans.
Et cela change beaucoup de choses.
Vénus, cette jumelle toxique de la Terre
Vénus est souvent décrite comme la sœur de la Terre. Elle a une taille et une composition similaires, mais la ressemblance s’arrête là. En surface, la température dépasse les 460 °C, et l’atmosphère, composée en grande partie de dioxyde de carbone et d’acide sulfurique, exerce une pression écrasante. L’enfer, version planétaire.
Ses nuages opaques et acides dissimulent la surface à toute tentative d’observation directe. Comprendre leur comportement, leur température, leur dynamique, reste un défi majeur pour les scientifiques.
Mais pour percer les secrets de Vénus, encore faut-il l’observer régulièrement. Et c’est là que le bât blesse.
Pourquoi étudier Vénus est si compliqué
Contrairement à Mars, qui accueille presque en permanence des sondes et des rovers, Vénus souffre d’un certain désintérêt opérationnel. Les missions spatiales à son encontre sont rares, brèves et souvent compromises par des contraintes techniques ou budgétaires. Résultat : il est très difficile de suivre l’évolution de son atmosphère sur de longues périodes.
Or, les variations de température, de vents ou de réflectivité de l’atmosphère vénusienne se jouent à l’échelle des années. Difficile, dans ces conditions, d’y voir clair sur son fonctionnement global.
C’est dans ce contexte qu’une idée originale a émergé : et si, au lieu d’envoyer une nouvelle sonde, on utilisait les instruments que nous avons déjà… autour de la Terre ?
Une « photobomb » cosmique pleine d’enseignements
Les satellites météorologiques japonais Himawari-8 et Himawari-9, lancés respectivement en 2014 et 2016, sont équipés de puissants capteurs infrarouges multispectraux (AHI), capables de suivre l’évolution des nuages terrestres avec une grande précision.
Mais dans certaines conditions géométriques, ces instruments peuvent également capter Vénus à l’horizon, en bord de champ. C’est ce que les chercheurs de l’Université de Tokyo, menés par Gaku Nishiyama, ont exploité avec brio.
En analysant les images collectées entre 2015 et 2025, l’équipe a identifié 437 moments où Vénus apparaissait dans le champ de vision des satellites. En mesurant la lumière infrarouge émise par les couches supérieures de son atmosphère, ils ont pu en déduire l’évolution des températures au sommet des nuages.
Une première mondiale.

Dix ans de météo vénusienne… sans quitter la Terre
Ces données, collectées depuis une orbite géostationnaire au-dessus de l’équateur terrestre, constituent la série d’observations continues de Vénus la plus longue jamais obtenue. Et elles révèlent de véritables tendances : les températures atmosphériques au-dessus des nuages changent d’année en année, ce qui suggère des dynamiques climatiques plus complexes que prévu.
C’est une avancée majeure pour la science planétaire. D’autant plus précieuse que les prochaines missions prévues vers Vénus — EnVision de l’ESA, DAVINCI et VERITAS de la NASA — ne décolleront pas avant la fin de la décennie. Et certaines, comme les projets américains, pourraient même être annulées ou repoussées à cause de restrictions budgétaires.
Un nouveau champ d’observation pour les satellites météo ?
L’équipe japonaise ne compte pas s’arrêter là. Ce qu’ils ont accompli pour Vénus pourrait aussi s’appliquer à la Lune, Mercure, ou d’autres corps célestes. En exploitant les bandes infrarouges captées par les satellites, il devient possible de suivre les variations thermiques et compositionnelles de ces objets, sans lancer de mission dédiée.
Comme le souligne Nishiyama, « cette approche ouvre une nouvelle voie pour la surveillance multibande et à long terme des corps rocheux du système solaire ». Une méthode opportuniste, économique, et qui pourrait grandement enrichir notre compréhension des mondes voisins.
Une vision poétique du ciel… depuis l’orbite terrestre
Dans cette histoire, il y a quelque chose de poétique. Des satellites pensés pour observer la Terre, nos typhons, nos nuages, nos sécheresses… deviennent les témoins lointains de ce qui se passe sur une autre planète. Ils regardent, par accident presque, une voisine infernale que nous comprenons à peine.
Et ce simple regard en coin, capté 437 fois en dix ans, pourrait bien relancer toute la recherche vénusienne.
Les détails de l’étude sont publiés dans la revue Earth, Planets and Space.