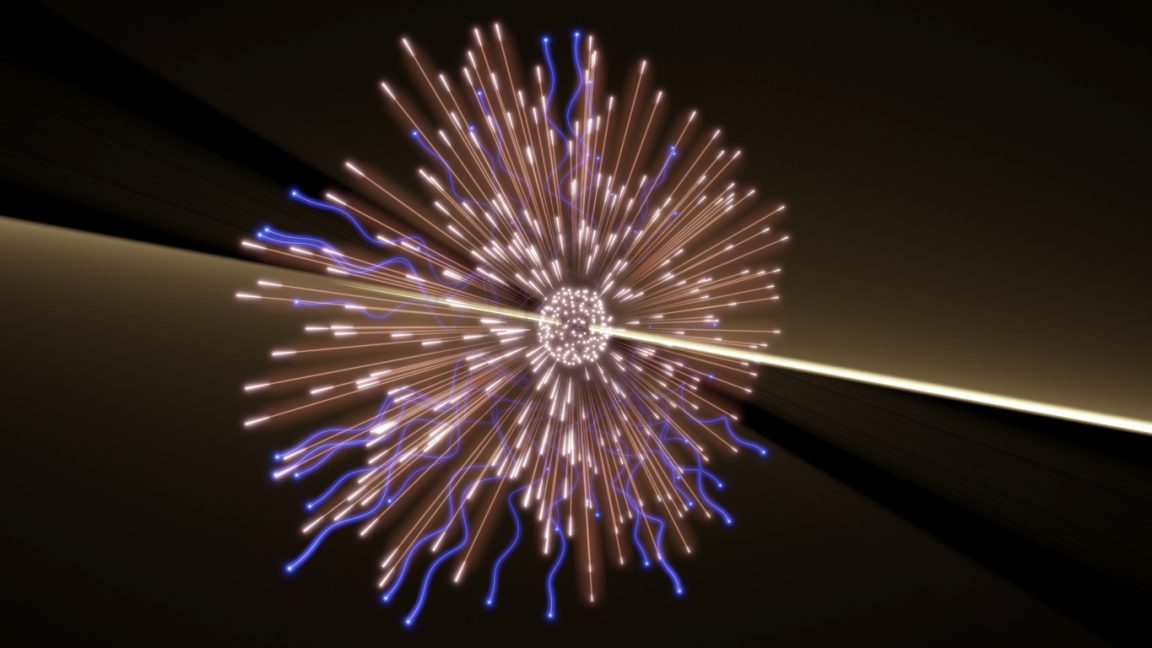Dans le cadre d’une nouvelle étude menée au LHC, des physiciens ont pu déterminer avec précision la largeur du boson W, une particule fondamentale impliquée dans les interactions faibles de la nature.
Des particules fondamentales telles que le boson W
La découverte du boson de Higgs en 2012 avait marqué une avancée majeure dans notre compréhension de la physique fondamentale en comblant une lacune cruciale dans le modèle standard. Cependant, cette percée laissait derrière elle des interrogations persistantes : qu’y a-t-il au-delà de ce cadre bien établi ? Où se cachent les nouveaux phénomènes capables de résoudre les mystères restants de l’Univers tels que la nature de la matière noire et l’origine de l’asymétrie matière-antimatière ?
Pour explorer ces questions, les chercheurs se tournent vers d’autres particules fondamentales, telles que le boson W. Ce dernier intervient dans les interactions nucléaires faibles qui représentent l’une des quatre forces fondamentales de la nature. Ces interactions sont responsables de processus tels que la désintégration bêta des noyaux atomiques. Le rôle de ce boson est plus précisément de transporter la force faible, ce qui lui permet d’influencer les désintégrations de particules.
L’importance de la masse
L’étude de la largeur du boson W revêt notamment une importance particulière. En effet, cette mesure est un paramètre crucial qui pourrait fournir des indices sur de nouveaux phénomènes physiques au-delà du modèle standard.
Dans le cadre d’une étude, la collaboration ATLAS a réalisé une nouvelle mesure de la largeur du boson W au LHC en utilisant les données de collision proton-proton. Notez que la largeur d’une particule est directement liée à sa durée de vie et qu’elle permet de prédire la manière dont elle se désintègre en d’autres particules. Ainsi, toute variation significative par rapport aux estimations pourrait indiquer la présence de phénomènes inexpliqués.
Pour clarifier davantage, lorsqu’un boson W se désintègre, il se transforme en d’autres particules, notamment des électrons ou des muons, ainsi que des neutrinos. Toutes ont une certaine impulsion ou énergie qui peut être mesurée et analysée par les détecteurs. En étudiant de près ces propriétés cinématiques, les chercheurs peuvent reconstruire les caractéristiques de la désintégration du boson W. Cela leur permet de déterminer la largeur naturelle de cette désintégration, c’est-à-dire la gamme d’impulsions possibles des particules émises.
En comparant cette mesure expérimentale de la largeur du boson W aux prédictions théoriques basées sur le modèle standard, les scientifiques peuvent alors évaluer s’il existe des écarts significatifs entre les deux. Si tel est le cas, cela pourrait finalement indiquer la présence de nouvelles particules ou de nouvelles interactions.

Quels résultats ?
Avec cette approche, les chercheurs ont obtenu une nouvelle mesure de 2 202 ± 47 MeV. Il s’agit de la plus précise réalisée à ce jour par une expérience. Bien que légèrement supérieure à la valeur prévue par le modèle standard (2,5 écarts-types près), elle reste cohérente avec celui-ci à un niveau statistique significatif.
En parallèle, ATLAS a également mesuré la masse du boson W, désormais estimée à 80 367 ± 16 MeV, offrant ainsi une mise à jour précise de cette valeur fondamentale. Là encore, les résultats obtenus sont en accord avec les prédictions du modèle standard, ce qui renforce la robustesse de cette théorie bien établie. Ces avancées ne sont toutefois que les premières d’une série de mesures à venir. Les futures analyses utilisant des ensembles de données plus vastes devraient en effet permettre de réduire davantage les incertitudes statistiques et expérimentales.
Les détails de l’étude sont publiés sur le serveur de préimpression arXiv.