Imaginer les premiers animaux qui ont peuplé notre planète fait souvent surgir des images de créatures primitives mais reconnaissables : peut-être des vers, des méduses ou d’étranges invertébrés aux formes fantastiques. La réalité pourrait être bien plus déconcertante. Selon une nouvelle étude menée par des géochimistes du MIT, les pionniers du règne animal auraient été des éponges marines, ces organismes mous et immobiles qui ressemblent davantage à des plantes qu’à des animaux. Une découverte qui repose sur des preuves moléculaires vieilles de plus de 541 millions d’années et qui bouleverse notre compréhension de l’arbre de vie.
Quand la chimie réécrit l’histoire
Contrairement aux fossiles traditionnels qui préservent la forme d’un organisme, les fossiles chimiques racontent une histoire invisible à l’œil nu. Il s’agit de vestiges moléculaires d’êtres vivants, enfouis dans les sédiments, transformés par la pression et le temps, mais conservant leur signature chimique distinctive. Ces empreintes moléculaires peuvent traverser des centaines de millions d’années sans disparaître complètement.
Dans le cas présent, les chercheurs se sont intéressés à des molécules particulières : les stéranes, formes géologiquement stables des stérols comme le cholestérol. Ces composés sont caractéristiques des membranes cellulaires d’organismes complexes et leur présence dans des roches anciennes indique sans équivoque qu’une vie animale sophistiquée existait déjà à cette époque.
Les échantillons analysés proviennent de roches datant de la période édiacarienne, il y a plus de 541 millions d’années, bien avant l’explosion cambrienne qui verra apparaître la plupart des grands groupes d’animaux que nous connaissons aujourd’hui.
Une énigme vieille de quinze ans résolue
Cette découverte ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans la continuité de travaux menés dès 2009 par la même équipe, qui avait alors identifié des stéranes à 30 atomes de carbone dans des roches d’Oman. Ces composés rares avaient été associés à d’anciennes éponges, mais cette conclusion avait suscité un débat scientifique nourri. Certains chercheurs suggéraient des origines alternatives, y compris des processus purement chimiques sans intervention biologique.
Pour lever toute ambiguïté, l’équipe du MIT a poussé l’investigation plus loin en cherchant un composé encore plus rare : un stérol à 31 atomes de carbone. Leurs analyses ont révélé non seulement la présence de ce marqueur dans les roches anciennes, mais aussi des concentrations étonnamment élevées de sa forme fossilisée.
Roger Summons, paléobiologiste du MIT et auteur principal de l’étude, souligne l’importance de cette patience scientifique : ces molécules étaient présentes depuis toujours dans les échantillons, mais il fallait savoir quelles questions poser pour les trouver et comprendre leur signification réelle.
Trois preuves pour un verdict définitif
La force de cette recherche réside dans sa méthodologie triangulaire. Plutôt que de s’appuyer sur une seule ligne de preuves, les scientifiques ont construit un dossier à partir de trois sources indépendantes convergeant vers la même conclusion.
Premièrement, la présence dans les roches anciennes de stéranes à la fois de 30 et 31 carbones dans des proportions spécifiques. Deuxièmement, l’analyse d’éponges démosponges vivantes montrant que certaines espèces actuelles produisent encore ces mêmes stérols particuliers. Troisièmement, la reproduction synthétique de ces composés en laboratoire pour confirmer leur structure et leurs propriétés.
Cette triple validation élimine pratiquement toute possibilité de contamination ou d’erreur d’interprétation. Comme l’explique l’équipe, authentifier un biomarqueur exige de prouver qu’un signal chimique provient réellement de la vie et non d’une pollution moderne ou d’une réaction géologique non biologique.
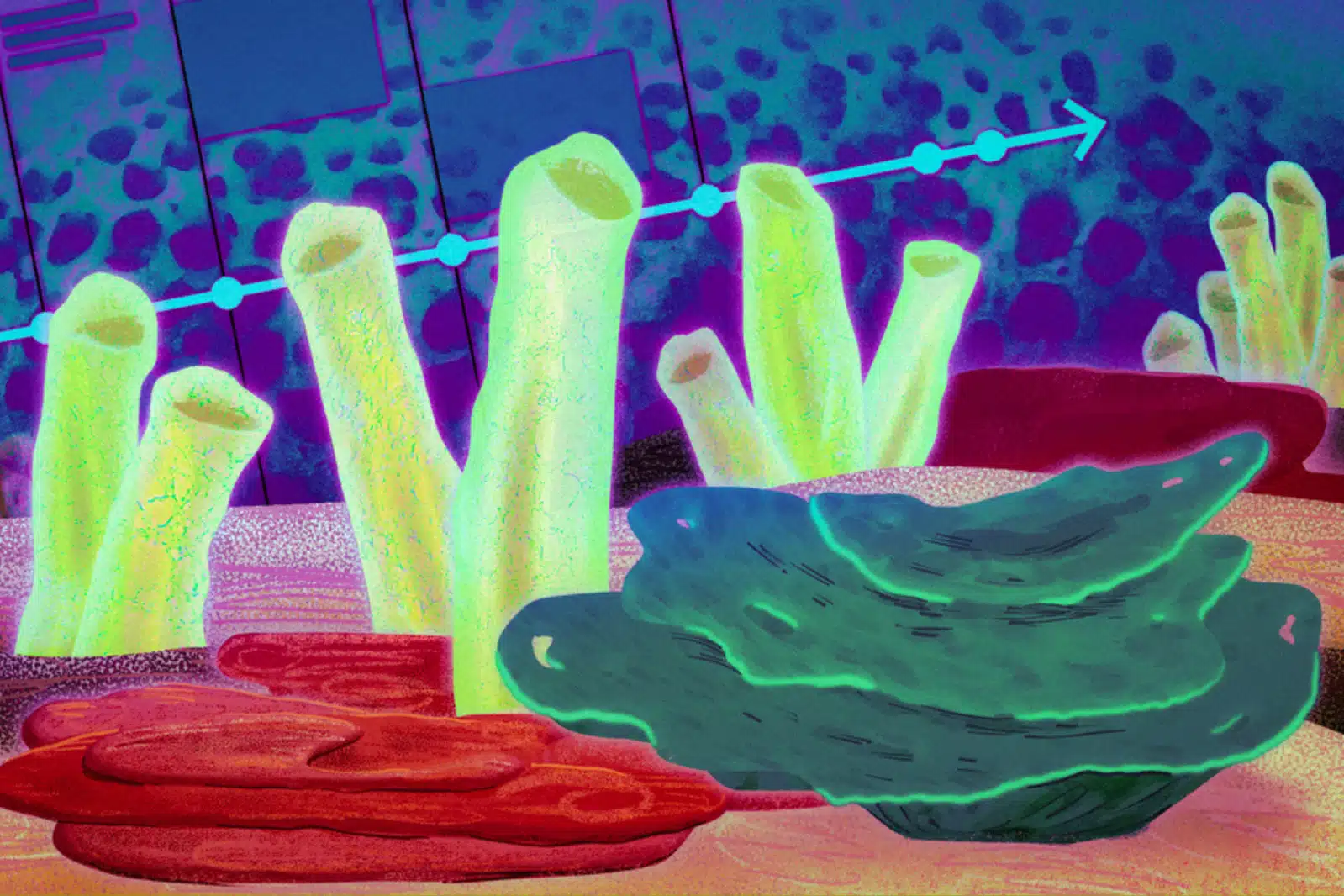
Des créatures déroutantes aux origines du vivant
À quoi ressemblaient ces pionniers du règne animal ? Certainement pas aux éponges colorées et structurées que l’on trouve aujourd’hui dans les récifs coralliens. Ces ancêtres des démosponges auraient vécu dans les océans primitifs, dotés d’un corps entièrement mou et dépourvu du squelette de silice qui caractérise beaucoup d’éponges modernes.
Ils auraient fonctionné comme des filtreurs, aspirant l’eau de mer pour en extraire les particules nutritives, un mode de vie qui n’a guère changé depuis plus d’un demi-milliard d’années. Sans système nerveux, sans organes différenciés, sans capacité de mouvement, ces organismes représentent pourtant une étape cruciale dans l’histoire de la vie : le passage des organismes unicellulaires aux animaux multicellulaires.
Cette découverte rappelle que l’évolution ne progresse pas en ligne droite vers la complexité. Les éponges, dans leur simplicité apparente, ont conquis les océans bien avant que n’apparaissent les premiers prédateurs, les premiers cerveaux ou les premiers yeux. Elles demeurent aujourd’hui encore des animaux prospères, preuve que la sophistication anatomique n’est pas toujours un gage de réussite évolutive.


