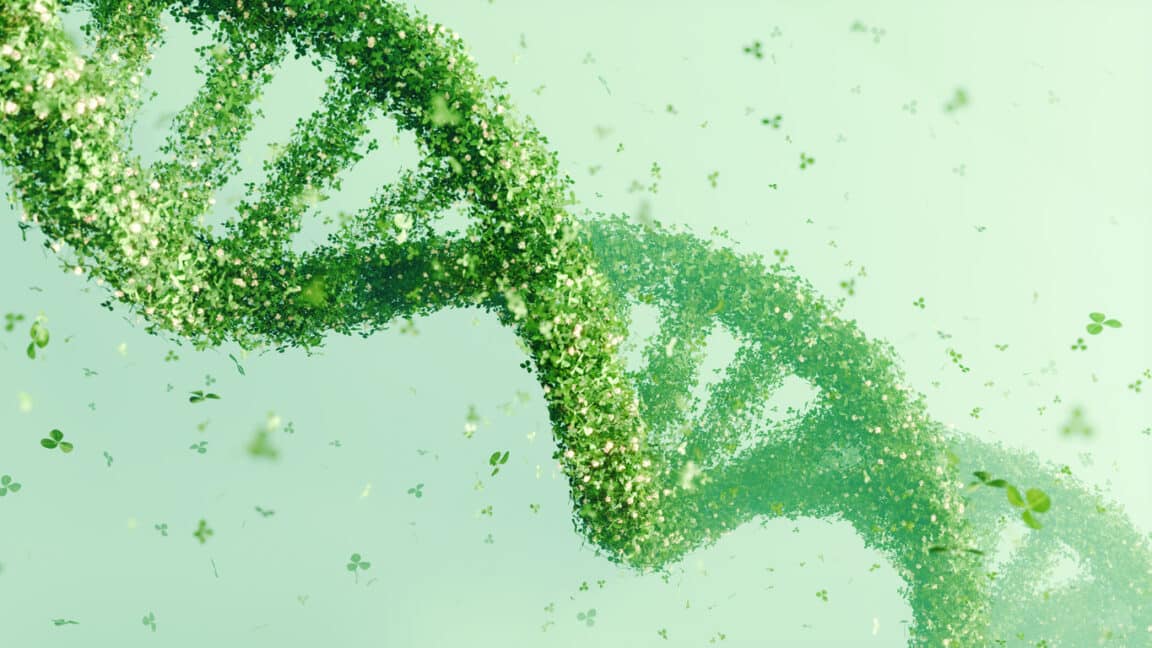À 24 ans, il dévoilait au monde la clé de l’existence elle-même. Sept décennies plus tard, l’homme qui avait révolutionné notre compréhension de l’humanité terminait sa carrière en la déshonorant. James D. Watson s’est éteint à 97 ans, laissant derrière lui un paradoxe aussi troublant que fascinant : comment celui qui a compris la mécanique intime de ce qui nous unit tous a-t-il pu consacrer ses dernières années à nous diviser ?
L’éclair de génie qui changea le monde
Printemps 1953. Dans un laboratoire de Cambridge, un jeune chercheur américain manipule des morceaux de carton découpés avec soin. Chaque fragment représente un composant de cette molécule mystérieuse qu’on appelle l’ADN. Soudain, l’évidence lui saute aux yeux : ces pièces s’assemblent comme les barreaux d’une échelle qui se tord sur elle-même. « C’est tellement beau », murmure-t-il.
Cette intuition fulgurante de Watson, conjuguée au travail acharné de son partenaire Francis Crick et aux données cristallographiques de Rosalind Franklin, allait déclencher une révolution scientifique sans précédent. La structure en double hélice de l’ADN n’était pas qu’une jolie forme : elle expliquait instantanément comment l’information génétique se transmettait de génération en génération. Lors de la division cellulaire, les deux brins se séparent comme une fermeture éclair, permettant la duplication du code de la vie.
Le prix Nobel de chimie tomba en 1962, consacrant trois hommes pour cette découverte capitale. Franklin, elle, était décédée quatre ans plus tôt, à 37 ans seulement, emportant avec elle la reconnaissance qu’elle méritait.
Un bâtisseur de légendes scientifiques
Watson ne s’est jamais reposé sur ses lauriers. Incapable de reproduire ce coup d’éclat en laboratoire, il a choisi une autre voie : celle de l’architecte du savoir. À Harvard, il forge le programme de biologie moléculaire. Au laboratoire de Cold Spring Harbor, qu’il dirige pendant près de quatre décennies, il transforme une institution modeste en temple mondial de la recherche génétique.
Sa contribution la plus ambitieuse ? Prendre les rênes du projet de séquençage du génome humain entre 1988 et 1992. Cette entreprise colossale visait à cartographier l’intégralité de notre patrimoine génétique. Watson y apporta une décision visionnaire : investir massivement dans la recherche éthique, conscient que déchiffrer l’ADN humain soulèverait des questions morales redoutables. Cette décision, annoncée presque par hasard lors d’une conférence de presse, reste selon lui « la chose la plus sage » qu’il ait accomplie.
Sa motivation était profondément personnelle. Son fils Rufus avait été diagnostiqué avec une possible schizophrénie, et Watson espérait que percer les secrets du génome permettrait de comprendre et traiter cette maladie.

La chute d’un colosse
Puis vint 2007. Dans une interview au Sunday Times, Watson déclara être « pessimiste quant à l’avenir de l’Afrique » car « tous les tests » prouveraient l’infériorité intellectuelle des populations noires. Le tollé fut immédiat. Suspendu, puis contraint à la retraite, le prix Nobel présenta des excuses avant de se rétracter. En 2019, interrogé sur ses convictions, il répondit sans ambages : « Non, pas du tout », elles n’avaient pas changé.
Le laboratoire qui l’avait porté au sommet lui retira ses titres honorifiques. La communauté scientifique, stupéfaite, découvrait qu’un esprit capable de percer les mystères de la biologie moléculaire pouvait simultanément épouser des thèses scientifiquement infondées et moralement répugnantes. Francis Collins, alors directeur des Instituts nationaux de la santé, résuma le malaise général : « Je regrette que la vision de Jim sur la société et l’humanité n’ait pas été à la hauteur de ses brillantes intuitions scientifiques. »
Un héritage indélébile et contradictoire
La double hélice ornera à jamais nos manuels scolaires, nos timbres-poste et même les toiles de Salvador Dalí. Elle a permis d’identifier des criminels, de retracer nos ancêtres, de soigner des maladies génétiques et de créer des organismes modifiés. Watson avait raison sur un point : lui et Crick avaient fait « la découverte du siècle ».
Mais en 2018, lorsqu’un journaliste lui demanda si un bâtiment du laboratoire portait son nom, sa réponse résonna comme un aveu involontaire : « Non, je n’ai pas besoin d’un bâtiment à mon nom. J’ai la double hélice. »
Avait-il vraiment la double hélice ? Ou l’avait-il perdue le jour où il décida que cette molécule universelle, identique chez tous les humains, justifiait paradoxalement leur inégalité ? L’histoire retiendra cette ironie cruelle : l’homme qui prouva notre parenté biologique commune passa ses dernières années à nier ce qu’impliquait sa propre découverte.