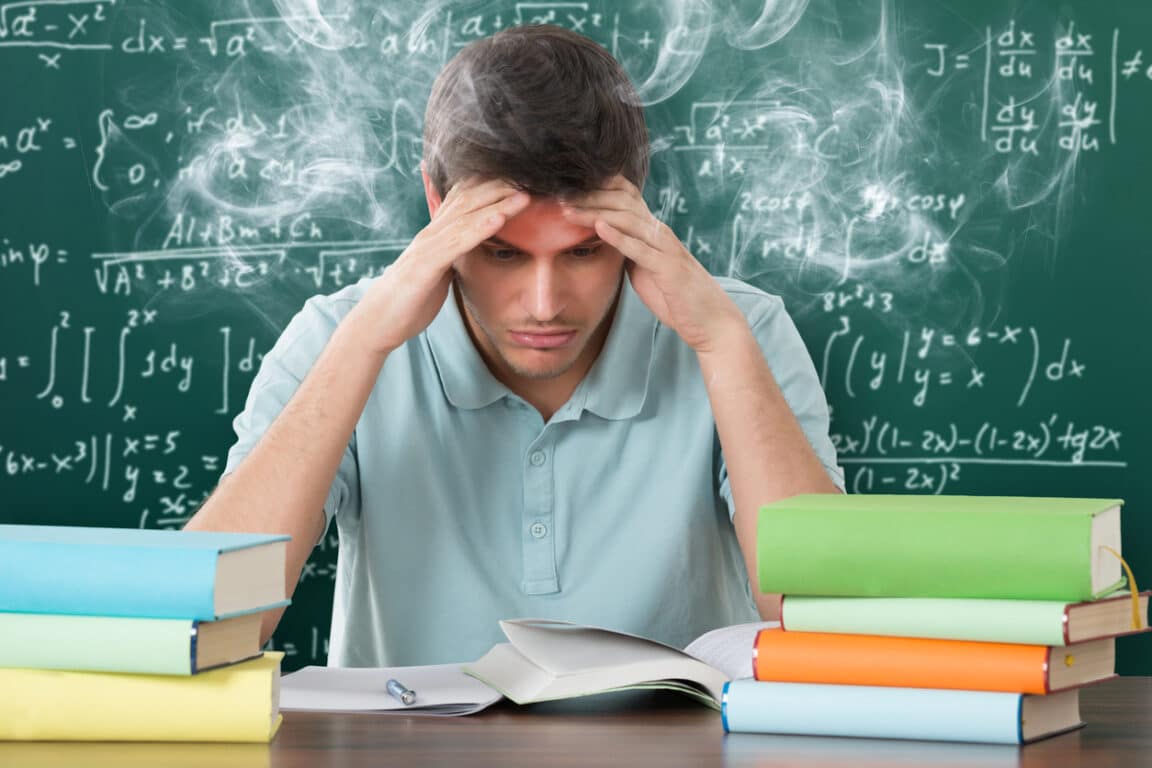Peut-on vraiment créer quelque chose à partir de rien ? C’est la promesse étrange – et terriblement contre-intuitive – d’un résultat mathématique appelé le paradoxe de Banach-Tarski. Selon lui, il serait possible de découper une sphère en un nombre fini de morceaux, puis de réassembler ces morceaux pour obtenir… deux sphères de même taille et de même volume que l’originale. En d’autres termes, 1 deviendrait 2. Absurde ? Oui. Légitime ? Aussi.
Une histoire de poisson d’avril devenu sérieux
L’histoire de ce paradoxe a même inspiré une petite panique. En 1989, un mathématicien publie dans Scientific American une chronique expliquant comment, grâce à ce résultat, on pourrait fabriquer de l’or à partir d’une simple boule. Le Conseil international de l’or s’en inquiète officiellement, craignant un effondrement du système monétaire mondial. La blague : l’« inventeur » à l’origine de la découverte s’appelait… Arlo Lipof, anagramme de « poisson d’avril ».
Mais derrière la farce, il y a bien un vrai théorème, démontré en 1924 par deux mathématiciens polonais, Stefan Banach et Alfred Tarski. Et il dit quelque chose de fascinant : les mathématiques ne fonctionnent pas toujours comme notre intuition physique.
Quand l’infini brouille notre logique
Pour comprendre, il faut plonger dans l’univers des ensembles infinis. Prenons les entiers : 1, 2, 3, 4… Il y en a une infinité. Maintenant, prenons les carrés parfaits : 1, 4, 9, 16… Il y en a aussi une infinité. Mais au premier abord, il semble évident qu’il y a « moins » de carrés que d’entiers, puisque beaucoup d’entiers ne sont pas des carrés.
Galilée avait déjà noté ce paradoxe : en réalité, on peut associer chaque entier à son carré. Cette correspondance parfaite montre que ces deux ensembles ont la même « taille » mathématique, qu’on appelle un infini dénombrable.
Il existe cependant un autre type d’infini : l’infini indénombrable, comme celui des nombres réels (tous les décimaux possibles entre 0 et 1, par exemple). Là, impossible de les « compter », car on peut toujours en trouver un nouveau entre deux nombres, aussi proches soient-ils. Cet infini-là est encore plus grand.
Et c’est exactement ce type d’infini qui entre en jeu dans le paradoxe de Banach-Tarski.
Une orange qui se dédouble
Imaginons une orange parfaite, représentée en mathématiques comme une sphère composée d’un nombre infini de points. Banach et Tarski montrent qu’en utilisant certaines rotations bien choisies, on peut séparer les points de cette sphère en un petit nombre de groupes très particuliers.
Ces groupes ne ressemblent pas du tout à des morceaux ordinaires : ce ne sont pas des quartiers d’orange qu’on pourrait tenir dans la main, mais des ensembles infinis de points, impossibles à visualiser. Et pourtant, une fois découpés ainsi, ces ensembles peuvent être réassemblés pour former… deux oranges identiques à l’originale.
C’est là que naît l’illusion : on a l’impression d’avoir créé de la matière à partir de rien, mais en réalité, tout repose sur la façon dont les mathématiques traitent l’infini.
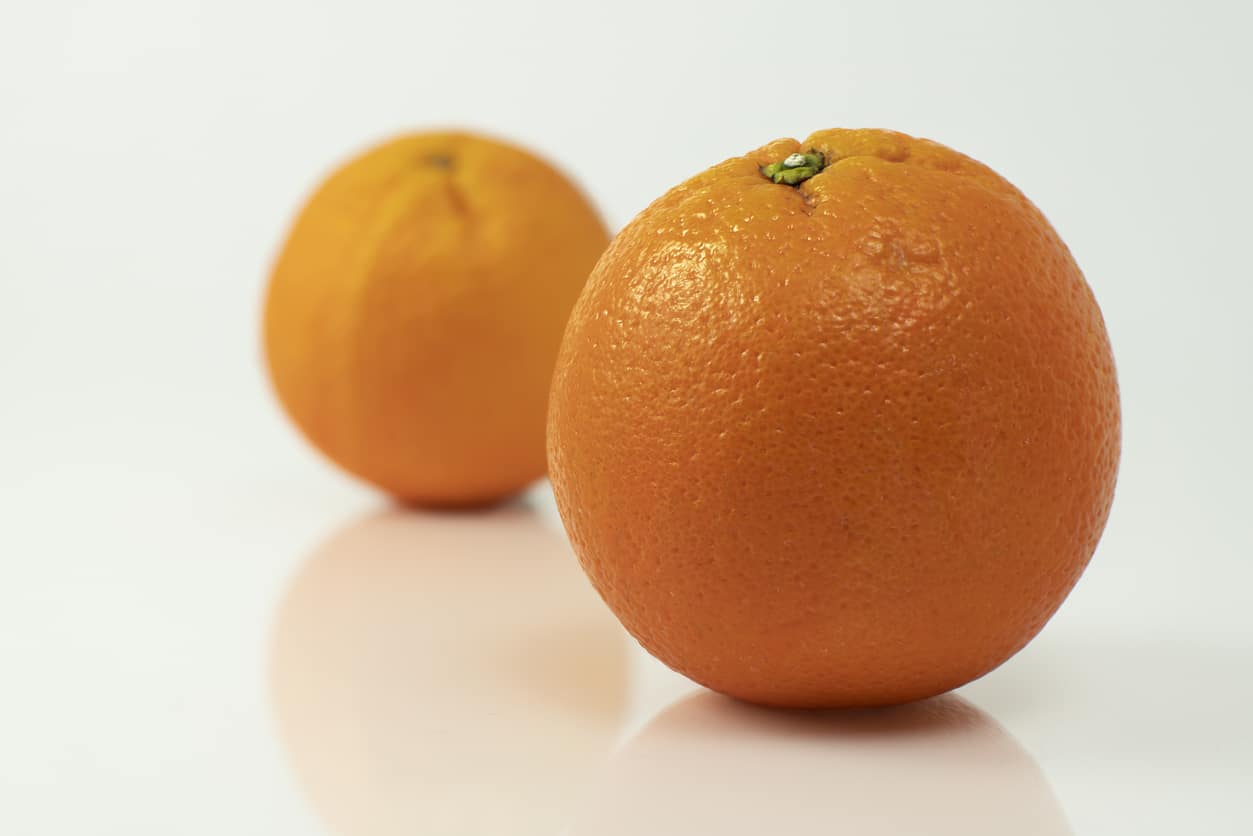
Crédit : iStock
Crédits : Simon Preshous/istockPourquoi ça ne marche pas dans la vraie vie
Rassurez-vous : personne ne pourra jamais doubler sa fortune en découpant une pièce d’or. Le paradoxe de Banach-Tarski ne s’applique pas au monde physique. D’abord parce qu’il suppose que la matière est faite de points infiniment petits et divisibles à l’infini – ce qui n’est pas le cas. Nos atomes, eux, ne se laissent pas morceler sans limite.
Ensuite parce que cette démonstration repose sur un outil mathématique appelé axiome du choix. Cet axiome est largement accepté, car il permet de démontrer beaucoup de résultats utiles, mais il est aussi… indémontrable. En clair : on choisit d’y croire, un peu comme un postulat. Sans lui, le paradoxe ne tient pas.
Un miroir des bizarreries mathématiques
Ce paradoxe ne remet donc pas en cause les lois de la physique, mais il révèle à quel point les mathématiques peuvent parfois nous déstabiliser. Dans leur univers abstrait, elles suivent une logique impeccable, mais qui ne correspond pas toujours à notre expérience du monde.
C’est aussi ce qui les rend si fascinantes : elles nous obligent à questionner nos intuitions, à accepter que 1 puisse, dans certaines conditions, donner 2.
Alors, non, personne ne créera d’or ou d’oranges en multipliant les sphères. Mais le paradoxe de Banach-Tarski nous rappelle une vérité essentielle : l’infini n’obéit pas à nos règles. Et quand les mathématiques s’en emparent, le réel peut vite sembler très étroit.